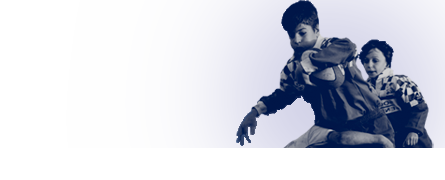L’esprit de club, raison d’être du rugby
« La Vie au Grand Air » - février 1914
par Louis Dedet [1].
Ceux qui voient se presser autour de nos pelouses actuelles une foule vibrante de trente-cinq mille personnes, passionnées, fidèles et rien moins que profanes, ne peuvent, même avec le plus grand effort, s’imaginer les déserts où s’agitèrent nos premiers enthousiasmes et se fit notre apprentissage.
-

- Lane, Duval, J. Dedet, Leuvielle, Boyau.
Mais ce qui est le plus étonnant encore que la conquête du public, c’est la prise de possession du jeu lui-même par l’armée de footballeurs répandue dans la France entière. Ceux d’aujourd’hui ne pourront jamais, fussent-ils d’une verve imaginative toute méridionale, réaliser de façon adéquate les premiers pas, les premiers gestes ni par conséquent les progrès accomplis.
Que de critiques à courte vue - où à court de copie - se lamentent de nos défaites internationales et clament leur désespoir. Qu’ils déclarent toute chance perdue de jamais nous voir sur un pied d’égalité avec nos rivaux d’outre-Manche ; qu’ils demandent qu’on abandonne toute lutte, cela prouve seulement ou qu’ils sont nés d’hier, ou qu’ils ont la plus déplorable des mémoires.
Car, voyez-vous, pour en arriver où nous sommes (et personne mieux que moi ne mesure toute la longueur du chemin encore à parcourir), il nous a fallu, étape par étape, retrouver, réinventer le rugby. Ne croyez pas que quelqu’un soit venu apporter parmi nous, un beau jour, la bonne parole, codifiée avec précision dans un enseignement méthodique. Joueurs de la génération actuelle, à qui les anciens déversent, aidés de professionnels grassement payés, les conseils les plus minutieux et les exemples les plus démonstratifs, ne croyez pas que nous ayons eu, nous aussi, nos maitres, venus juste à point pour nous révéler les beautés du jeu et nous assouplir à ses finesses. Le premier grand maitre du rugby en France, M. Heywood, fut (horresco referens) un joueur d’association ! Nous devinâmes, comme nous pouvions le faire, d’après les livres, d’après les comptes rendus de journaux anglais, l’essentiel de la tactique. Et l’on peut citer les inventeurs, presque les dates d’invention, des différents coups - aujourd’hui de pratique courante, - comme on signale les divers perfectionnements de la machine à vapeur ou du télégraphe. Les frères Candamo, du Racing, introduisirent le passer-ballon, décrié d’abord comme une lâcheté et un abandon. Giroux, du Stade, découvrit un beau jour le charme reposant et l’utilité du coup de pied en touche. Moi-même, j’ai appris par une gifle retentissante qu’il valait mieux arrêter bas. Nous découvrîmes aussi, comme des régions inconnues, mystérieuses et suaves dans leur nouveauté, la mêlée, l’art de talonner et l’utilité de marquer les adversaires à la touche. Chaque progrès fut une vraie conquête et due nommément à l’un ou à l’autre des quelques quarante joueurs qui deux fois par semaine, s’ébattaient pèle-mêle, toujours les mêmes, sur une pelouse exiguë du Bois de Boulogne.
Il fallut les premières rencontres internationales pour nous faciliter la tâche d’apprendre. Mais, là encore, nos maitres ne furent pas tout de suite de premier choix. D’ailleurs, même un « Manningham », qui, dès 1893, nous donnait une vraie démonstration du jeu le plus beau, le plus typique, avait en nous des élèves trop neufs pour profiter d’une telle maîtrise. Nos voisins les Anglais apprennent à jouer dès le berceau. Fils de footballeurs, ils entendent et voient en « footballers » dès qu’ils peuvent comprendre et distinguer. Les conversations autour d’eux sont plus souvent de rugby que de littérature, de Poulton ou de Bancroft que de Shakespeare, de Keats ou de Shelley. Nous, nous n’avions pas encore La Vie au Grand Air et ses savantes chroniques ! Le monde ne parlait qu’assez peu de nos exploits, et nos préoccupations correspondaient mal à celles de la majorité de nos contemporains. Joignez à cela le petit nombre des pratiquants, le choix très restreint d’athlètes. Vraiment, il est inconcevable et miraculeux que nous ayons si vite conquis le pays français, quand on songe à l’exiguïté de nos moyens d’action initiale. Et l’on est bien mal fondé, se souvenant d’hier, à ne pas mettre tout espoir en demain.
D’autant que l’évolution du jeu et de la tactique s’est faite entièrement dans le sens de nos qualités françaises individuelles. Nos maitres de 1892 et 1893 eux-mêmes avaient beaucoup à apprendre. Ceux de cette époque qui se souviennent des Bieber et des Todd, géants au jeu effectif et lent, se peuvent rendre compte que le jeu d’aujourd’hui ressemble à celui d’alors comme le sautillement aisé d’une gazelle ressemble à la puissante, mais lourde, démarche de l’ours polaire !
Peut-être même est-on allé trop loin dans le sens de la rapidité un peu désordonnée et aventurée. Nos lentes, compassées, mais judicieuses et progressives évolutions, risquaient moins que les folles et endiablées attaques actuelles ; mais elles conduisaient à une victoire sûre par une marge modeste, suffisante, cependant, de quelques points. Je doute qu’elles eussent passionné le grand public. Mais le grand public était bien la chose dont nous nous préoccupions le moins et nous jouions simplement, en vrais amateurs, pour nous, et pour la joie d’échanger, entre amis, quelques aménités parlantes et agissantes. Je ne me rappelle pas avoir jamais éprouvé les fantastiques et déconcertants résultats qu’on enregistre actuellement : des équipes qui dominent durant une mi-temps et marquent des vingtaines de points, pour se transformer subitement en déplorables écumoirs et être finalement battues d’une dizaine d’essais. Nous en aurions péri, nous, de courte honte. Et on aurait laissé là, je crois, de dépit, ballon et maillots, nous jugeant définitivement bons pour le rebut, et tout voisins du déshonneur !
Comme il était naturel, le grand public a façonné le jeu comme il le lui fallait. Au fond, même en Angleterre, le rugby a envié à l’Association son succès de spectacle et ses grandes foules, dues à la vivacité d’une partie qui ne peut ni s’arrêter ni même se ralentir. Autrefois, on jouait le rugby pour lui-même. Peu importaient les interminables mêlées, fastidieuses pour la galerie. Les joueurs y éprouvaient toute les joies désirées de la lutte corps à corps, de la lutte douloureuse, virile, triomphante. Maintenant, on joue pour plaire, la virtuosité a remplacé la dévotion. Or, les « New-Zelanders », les fameux et incomparables « All Blacks », sont justement venus montrer au monde du rugby, étonné et conquis, leur prestigieuse et triomphante virtuosité, au moment où chacun, spectateurs et joueurs, ressentait la lassitude des spectacles monotones et des tactiques toujours les mêmes. Dès lors, la foule était conquise et la nouvelle tactique régnait : le rugby pouvait, comme sa soeur l’association, devenir un spectacle et cesser d’être un rite.
Ce n’est pas faire une injustice aux joueurs français, et spécialement aux joueurs du midi de la France, de dire qu’ils étaient spécialement adaptés à ce rugby-spectacle, rugby à pétarades, à fusées et, comme on a dit, « feu d’artifice ». Jouer comme on officie ne répond pas à beaucoup de natures et nos tempéraments français sont moins portés aux rites compassés qu’aux manifestations de virtuosité et d’éclat.
Il n’est donc pas étonnant que nous ayons, en France, adopté et comme consacré le rugby actuel, dans ce qu’il a de plus mousseux, de plus prestigieux, mais aussi de moins sûr et de moins solide. Nous avons nettement exagéré ce qu’il avait déjà de très aventureux chez les Zélandais ; mais nous n’avons ni leurs qualités ni leur merveilleux entraînement pour empêcher que l’aventure ne devienne mésaventure ! Ne nous étonnons donc pas, non plus, si nous frisons souvent une victoire, muée brusquement en amère défaite ; si nous sommes mis en cruelle difficulté, au moment même où nous nous croyions menaçants. Ce sera encore bien des années ainsi. Et je ne crois guère que nous ayons beaucoup de chance d’en revenir à une méthode, à une tactique plus pondérée, moins brillante, mais moins dangereuse aussi. Il faut aller dans le sens de son tempérament.
Cependant, ne peut-on vraiment rien pour précipiter et aussi diriger les progrès du football français ? Sa vingt-cinquième année, qui marque sa grande majorité, doit-elle l’émanciper au point qu’il n’y ait plus qu’à être spectateur de son activité, sans espoir de la régler ?
-

- Un match Stade-Racing en 1903
- En 1903, le Stade et le Racing combattaient déjà avec acharnement. On peut se rendre compte, cependant, du peu de rapidité du jeu et de la différence qui existe avec la méthode actuelle. L’envahissement des touches par le public est aussi témoin des mœurs disparues.
Non pas ! Et je crois que la méthode des bras croisés serait peu recommandable. Or, susciter de grandes rencontres, battre le rappel des foules, c’est bien. Mais cela devrait constituer un couronnement. Ce n’est pas parce que cinquante mille spectateurs viendront voir jouer l’équipe de France que la tactique de cette équipe sera supérieure ou ses progrès indéniables. Mais, parce que nous savons que maintenant tout un peuple de fidèles suit nos équipes, nous devrions avoir à cœur qu’elles fussent les plus dignes de leurs admirateurs et les plus parfaites.
Or, j’ai peur que nous ne soyons légèrement endormis dans la routine en ce qui concerne l’organisation sportive du rugby en France. Je vois toujours, par exemple, le même championnat de France par clubs qui occupait nos pensées et nos efforts en 1892. Seulement, en 1892, il avait deux concurrents et tous deux parisiens. De la sorte, l’affaire était vite réglée, en un seul match, et nous pouvions penser à autre chose durant une partie de la saison : par exemple, à faire des progrès, ou à former des joueurs, ou à recruter quelques nouveaux éléments, à faire du sport enfin. Maintenant et depuis bon nombre d’années déjà, depuis surtout que l’on a, contrairement à mon avis, doublé les rencontres de championnat d’un match retour, on est absorbé pendant six mois sur six par la préoccupation de jouer chaque dimanche une partie décisive, d’où dépendent toute la gloire du club et tout l’espoir du championnat. Alors, c’est une ruée éperdue vers les joueurs disponibles, une recherche fiévreuse de l’équipier douteux, un replâtrage de hasard après les matches à accident ; et, sur le terrain, la plus déplorable, la plus anti-sportive, la plus discourtoise des rencontres : la partie de championnat dans toute son horreur. Il est vrai que, au bout de six mois de cet exercice, selon le hasard des accidents et des indisponibilités, finissent par se trouver opposées des équipes qui ont dû, surtout et avant tout, couvrir quelques centaines de kilomètres et qui auront à se rencontrer des deux extrémités du territoire ! Glorieuse incertitude du sport ! pendant ce temps-là, les jeunes joueurs, les éléments de demain, les équipes en formation sont sacrifiés à une sorte de cuisine mystérieuse, souvent malpropre, d’où sort, comme elle le peut, l’Équipe.
Eh bien ! je dis que tant que nous procéderons ainsi, nous accentuerons les défauts actuels du rugby français loin de les atténuer, défauts qui sont l’émiettement, le manque de solidarité, de compréhension réciproque et de discipline. Nous n’aurons jamais une Équipe de France, mais des représentants de l’esprit d’équipe, de la tactique de club, représentants destinés à ne jamais s’amalgamer, à ne jamais parler que des langues différentes, si j’ose dire, le jour où on leur demandera de travailler en groupe pour le pays.
Ou bien il faut renoncer à constituer un « quinze » français, un football français, une méthode ascendante et progressive du football français, ou bien il faut abandonner la vieille formule des vives, mais louches et aigres compétitions locales, de club à club ; à jeter bas l’organisation vermoulue du championnat tel qu’on le pratique depuis vingt-cinq ans ; trouver une conception plus large, plus compréhensive, qui sauve les joueurs, la tactique, le football français tout entier des mesquines rivalités et des oppositions énervantes où la lutte, exclusivement de club à club, enferme, chambre, enrobe et étouffe le joueur et le jeu français. A bas le championnat de France tel qu’il est compris actuellement !
LOUIS DEDET